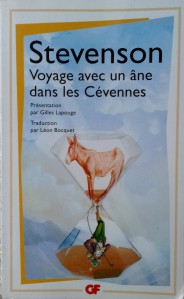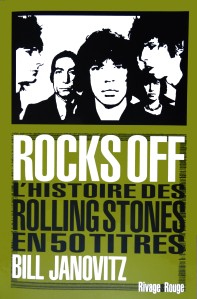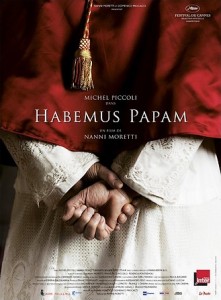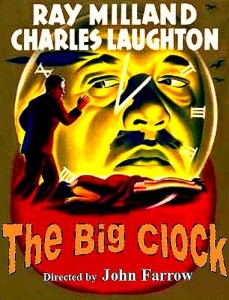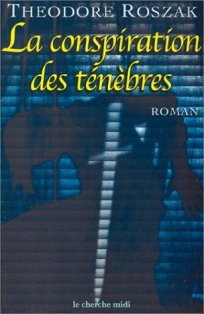Black Mirror – saison 3 (2016), série créée par Charlie Brooker.
 1) Nosedive : A la moindre interaction sociale, chacun peut -doit- attribuer une note à l’autre d’un coup de pouce sur son Smartphone. Attention, si votre moyenne descend trop…
1) Nosedive : A la moindre interaction sociale, chacun peut -doit- attribuer une note à l’autre d’un coup de pouce sur son Smartphone. Attention, si votre moyenne descend trop…
2) Playtest : Grâce à un minuscule implant, tester une nouvelle génération de jeux en 3D absolue qui vous immerge physiquement à l’intérieur du jeu, le rêve de tout gamer ?
3) Shut up and dance : Ce que vous avez fait quand vous étiez tout seul, face l’écran de votre ordinateur, dans la sécurisante solitude de votre chambre, a été enregistré via votre webcam et un inconnu menace d’envoyer cette vidéo à tous vos contacts ; jusqu’où êtes-vous prêt à lui obéir pour empêcher cette diffusion ?
4) San Junipero : Votre éternité, vous préférez la passer dans les années 80 ? Dans les années 90 ? Ou mourir ?
5) Men against fire : Pour faire de bon soldats, rien de tel que de faire de la réalité un immense shoot’em up.
6) Hated in the nation : Sur les réseaux sociaux, chacun peut poster ce qu’il veut, en toute innocence, il ne risque rien, non ?
 Bienvenue dans un monde aux couleurs pastel et aux dégoulinantes relations sociales dont l’apparence mielleuse cache une évaluation permanente de chacun par chacun (un rêve ultra libéral ultra démocratique, non ?), mesure constante de performance et mise en compétition chronique de tous contre tous ; dans un monde où pour se brancher une fille dans un pays inconnu, votre mobile vous permet quasi instantanément de trouver le profil qui matche avec le vôtre ; dans un monde où le dirigeant d’une prospère entreprise de pointe à la mode reste -probablement- impuni quoi qu’il fasse ; un monde où vos secrets les plus inavouables
Bienvenue dans un monde aux couleurs pastel et aux dégoulinantes relations sociales dont l’apparence mielleuse cache une évaluation permanente de chacun par chacun (un rêve ultra libéral ultra démocratique, non ?), mesure constante de performance et mise en compétition chronique de tous contre tous ; dans un monde où pour se brancher une fille dans un pays inconnu, votre mobile vous permet quasi instantanément de trouver le profil qui matche avec le vôtre ; dans un monde où le dirigeant d’une prospère entreprise de pointe à la mode reste -probablement- impuni quoi qu’il fasse ; un monde où vos secrets les plus inavouables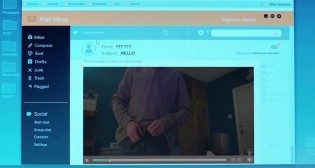 peuvent être livrés aux réseaux sociaux ; où le virtuel contamine le réel ; où mourir devient un choix personnel ; un monde sans plus aucun endroit où se cacher ; un monde où tout un chacun, sans cesse, clique, textote, poste, like, snapshote, tweete…
peuvent être livrés aux réseaux sociaux ; où le virtuel contamine le réel ; où mourir devient un choix personnel ; un monde sans plus aucun endroit où se cacher ; un monde où tout un chacun, sans cesse, clique, textote, poste, like, snapshote, tweete…
Les six épisodes de cette saison 3 de la série de Charlie Brooker, comme les deux précédentes, questionnent sur la place des nouvelles -futures ?- technologies. Mais loin d’être technophobe, si en bonne speculative fiction elle porte un regard volontairement pessimiste sur l’avenir proche, c’est pour interroger sur d’éventuelles conséquences de nouveaux comportements engendrés par l’évolution technologique et son omniprésence dans l’environnement quotidien. Car repoussant -presque- totalement l’angle paranoïaque qui situe le danger hors du spectateur (cf. tous ces films ou livres dans lesquels la menace technologique est aux mains, au choix, de l’état, d’une multinationale, d’une organisation secrète…, moteur parfois simpliste d’une dénonciation –réactionnaire ?- du progrès technique), le point fort de Black Mirror est de prendre le contre-pied de cette approche en se focalisant sur l’utilisation généralisée des objets issus de la recherche technologique devenus objets de la vie de tous les jours de Monsieur et Madame Toutlemonde ; et ainsi d’impliquer directement le spectateur pour lui donner matière à réflexion sur ses propres actes : cliquer sur la souris de son PC, passer le pouce sur l’écran de son Smartphone, sont-ce toujours des gestes anodins, sans conséquences ?
lesquels la menace technologique est aux mains, au choix, de l’état, d’une multinationale, d’une organisation secrète…, moteur parfois simpliste d’une dénonciation –réactionnaire ?- du progrès technique), le point fort de Black Mirror est de prendre le contre-pied de cette approche en se focalisant sur l’utilisation généralisée des objets issus de la recherche technologique devenus objets de la vie de tous les jours de Monsieur et Madame Toutlemonde ; et ainsi d’impliquer directement le spectateur pour lui donner matière à réflexion sur ses propres actes : cliquer sur la souris de son PC, passer le pouce sur l’écran de son Smartphone, sont-ce toujours des gestes anodins, sans conséquences ?
Black Mirror n’en oublie pas pour autant qu’elle est spectacle : réalisation, décors, acteurs, péripéties scénaristiques, tout à la qualité pour tenir le spectateur devant… son écran (!). La série joue même avec la culture de celui-ci, s’amusant à reprendre selon l’épisode les codes classiques de film de genres (romance, film d’horreur, de guerre, policier) ou modernisant d’un lustre technologique certaines séquences-clichés (la maison hantée, l’attaque d’insectes) ; et l’amateur de SF goutera au superficiel plaisir du happy few à y pointer ça et là des rapprochements avec les œuvres d’auteurs ou réalisateurs du genre (Richard Matheson, Philip K Dick, Greg Egan, David Cronenberg…).
l’épisode les codes classiques de film de genres (romance, film d’horreur, de guerre, policier) ou modernisant d’un lustre technologique certaines séquences-clichés (la maison hantée, l’attaque d’insectes) ; et l’amateur de SF goutera au superficiel plaisir du happy few à y pointer ça et là des rapprochements avec les œuvres d’auteurs ou réalisateurs du genre (Richard Matheson, Philip K Dick, Greg Egan, David Cronenberg…).
Si la série aborde aussi des thèmes plus généralistes tels les nouveaux moyens de manipulation permis par les avancées technologiques ou s’offre des échappées vers des interrogations existentielles sur la fiabilité de nos perceptions sensorielles ou sur l’avenir de la mort (!), loin du basique divertissement geek, l’intérêt de Black Mirror provient d’abord de ce que sans juger, moraliser ou imposer des réponses, en proposant potentialités -probables ou improbables-, elle interroge sur la mise à distance du réel que favorise l’interface d’un écran et partant, sur la dérive vers la déresponsabilisation individuelle.
interrogations existentielles sur la fiabilité de nos perceptions sensorielles ou sur l’avenir de la mort (!), loin du basique divertissement geek, l’intérêt de Black Mirror provient d’abord de ce que sans juger, moraliser ou imposer des réponses, en proposant potentialités -probables ou improbables-, elle interroge sur la mise à distance du réel que favorise l’interface d’un écran et partant, sur la dérive vers la déresponsabilisation individuelle.